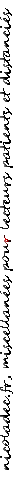|
option |  |
|
PROCESSIONS
U n historien doublé d’un géographe qui, dans le cadre d’une proxémique de la déambulation protestataire collective, se pencherait sur le thème de la marche collective de revendication, chercherait sans doute, comme on fait dans ces cas-là, à mettre en avant quelques manifestations significatives de cette pratique, pour en jalonner de grands exemples symboliques les étapes les plus significatives. Pour l’époque contemporaine, peut-être retiendrait-il l’une de ces grandes marches qui eurent lieu dans les années quatre-vingt, pour protester contre le nouveau fléau du siècle, le sida. Il y avait là en effet quelque chose d’assez mystérieux et de fascinant pour un esprit suffisamment conservateur pour être resté teinté de ce qu’on appelle curieusement chez nous, par une sorte de contresens savant, le cartésianisme. Car, bien qu’il existe tout de même ce qu’on nomme des manifestations de soutien (mais qui sont souvent en fait de soutien motivé en dernier ressort par une opposition), le genre commun en la matière consiste à marcher contre. On voit bien la métaphore guerrière qu’il y a là-dedans, nous y reviendrons. Mais enfin, il s’agit bien de s’opposer symboliquement, que ce soit contre le gouvernement, ou contre des ennemis moins bien hypostasiés, telles les injustices sociales. On pourrait donc estimer qu’une condition sine qua non pour que la chose soit signifiante, soit qu’un représentant plus ou moins valide de la chose incriminée puisse être en état d’interpréter cette valeur allégorique. |
|
Il faut bien, comme on dit, que le message soit reçu quelque part. Si c’est contre le gouvernement, on peut supposer qu’un ministre, même muni de l’intelligence moyenne à la catégorie, saisira la nuance d’opposition. S’il s’agit d’injustice sociale, on peut espérer qu’il y aura au moins un vilain riche, avec plein d’argent dans ses poches selon l’usage supposé de sa catégorie, qui sentira monter en lui l’affreuse culpabilité d’être responsable d’un monde si injuste, ou à défaut, et plus probable, qu’il y en aura quelques exemplaires à trembler de panique dans leurs escarpins. Mais quand il s’agit de marcher contre le sida ? Compte-t-on vraiment que le virus se laisse impressionner par un tel déploiement protestataire ? Qu’il comprenne enfin l’injustice hideuse de sa progression aveugle ? Il y a là tout de même une forme nouvelle de communication, à moins que ce ne soit que l’apogée d’une forme ancienne : une communication avec un émetteur, mais sans récepteur.
L’esprit plus sociologue (de méchants esprits traduiraient moins logique) arguera qu’il ne s’agit pas à proprement parler de manifester contre le sida, qu’on ne dit la chose ainsi que par présentation elliptique, comme on fait souvent, et que le véritable but est d’attirer l’attention sur. Remarquons d’abord qu’une bonne majorité des participants des susdits défilés (hm…) présentaient la chose comme manifestation contre le sida, un point c’est tout. Qu’il y ait ensuite des intellectuels de service pour colorer la chose d’intelligibilité, c’est monnaie courante, il y a même des professions dont c’est la fonction essentielle d’étayer d’interprétations secondes les pratiques trop primitives ou rudimentaires. Mais admettant même que le fond non exprimé ou mal exprimé de l’affaire, ait été d’attirer l’attention sur, on peut se demander l’attention de qui. De ceux qui ne marchent pas, et qui seraient censés être moins avertis, puisqu’ils ne marchent pas ? Ou censés moins agir, pour la même raison ? Et attirer l’attention sur quoi ? Des marcheurs bruyants attirent surtout l’attention sur le fait qu’ils marchent bruyamment. S’il s’agissait vraiment d’expliquer quelque chose, le plus efficace, pourrait-on croire naïvement, consisterait à l’expliquer. Et même en pratiquant de manière péripatéticienne, pour bien s’expliquer à un auditoire qui ne vous suit pas physiquement, il vaut mieux ne pas marcher trop loin.
Force est donc de se dire que cette affaire est quelque peu bidon dans ses prétentions avouées. On est sans doute plutôt dans ce mode paradoxal de communication de celui qui prie, et qui s’adresse avec conviction à un dieu qui n’existe pas (mais non). Le fait que celui-ci ne lui réponde jamais ne semble même pas lui mettre la puce à l’oreille. C’est qu’on ne se sent pas forcément seul à parler tout seul à son mur, car la conscience a cette propriété abyssale de se dédoubler, de se démultiplier en autant de partenaires qu’il lui sera utile. Elle est en plus capable de donner apparence de consistance à ces pures émanations internes de sa fantaisie. On en a bien vus qui croyaient à la réalité des universaux. Celui qui prie ne s’adresse qu’à lui-même, mais c’est tout de même un joli montage, une jolie mise en scène un tantinet perverse de lui-même qu’il effectue. Ceux qui manifestent ne s’adressent au fond qu’à eux-mêmes. Il n’y a d’ailleurs qu’eux-mêmes qui puissent s’entendre jusqu’au bout, puis qu’ils se déplacent. Une marche contre le sida ou contre la pédérastie est en soi aussi efficace qu’une danse indienne contre la sécheresse. Avec tout de même un trait qui semble plus subtil dans la danse indienne, son côté circulaire. Mais dans tous les cas, il ne s’agit de rien d’autre que de s’adresser à sa propre croyance, avec en toile de fond ces idées, si polluantes quand on en mésuse, de justice et d’injustice.
Les marches sont si diverses, qu’il y aurait là un beau travail d’anthropologie à entreprendre. Religieuses ou laïques, clamant des slogans ou silencieuses, hordes dévastatrices ou recueillement dans la dignité, lent déploiement coordonné porteur de banderoles, de portraits de la sainte victime, de cierges ou autres accessoires sacrés, ou course au pas Hô Chi Minh, il y a autant de styles de marches que de danses. Les contenus manifestes connaissent également une grande diversité, plus ou moins teintés de pseudo-réalisme, ou franchement allégoriques : la marche de protestation dans la dignité en hommage à la petite fille assassinée, démarche plus vigoureuse et bigarrée pour la revalorisation des minima sociaux, cortège d’enterrement pour mener nulle part quelqu’un qui n’existe plus, beau cortège aussi cérémonieux qu’interminable, pour donner le sens du divin, comme dans Parsifal, ou dans une messe papale, etc. Mais il y a dans tout cela une grande constante, qui est l’absence de relation réelle, l’absence de toute efficience possible, entre l’action même et le contenu manifeste, c’est-à-dire la revendication telle qu’elle est explicitée.
On peut en effet s’interroger sur la relation qui peut ainsi unir la marche et les différentes modalités de revendication. Il semble établi qu’il ne peut pas s’agir de cette ancienne liaison logique, qu’on pratiquait parfois encore vers le milieu du vingtième siècle, et que l’on appelait relation causale. Car franchement, de mettre un pied devant l’autre et de recommencer ne paraît pouvoir posséder une quelconque efficience objective sur aucun objet de nos contrariétés, si ce n’est peut-être en ce qui concerne les troubles de la circulation sanguine. Si l’on cherche du côté subjectif, là, on peut évidemment relier tout ce que l’on voudra au hasard, ce qui n’empêchera même pas une certaine efficacité de conviction. C’est ce que montrent à suffisance les Coué, Mesmer, et autres précurseurs ou plagiaires de l’effet placebo. Il n’y a donc pas à analyser les hypothétiques incidences objectives de la marche sur la réalité, telle qu’on l’entendait jadis, c’est-à-dire sur ce qui ne dépend pas de nous. On peut bien par contre tenter d’en élucider les arcanes psychologiques.
Il y a d’abord, bien sûr, le simple problème technique de savoir ce que l’on peut faire ensemble, quand on est beaucoup. C’est même sans doute le problème principal, qui non seulement passe avant, mais même supprime toute autre question qui serait relative à l’éventuelle efficience de l’action envisagée. Alors, que faire quand on est beaucoup, compte non tenu d’une quelconque efficacité sur le problème de référence ? A deux, on peut toujours faire une partie de cartes, à trois, faire l’amour, ou l’inverse, selon les goûts. Mais quand ça devient foule, se posent des contraintes techniques précises. Il faut mettre en scène l’action en extérieur, car en intérieur les possibilités sont plus limitées, et puis ça fait plus occupation d’un espace privé, et moins d’un espace social. Et comme on sait bien que tous les problèmes, infections virales comprises sont, dans leur cœur même, des problèmes sociaux, il faut les affronter dans un cadre spatial authentiquement social. C’est pour cela que tous les extérieurs ne conviennent pas de manière identique. Manifester au milieu d’une pâture, par exemple, ne convient pas. Ca fait trop rural, trop isolé, trop individualisme paysan, et il n’y a généralement pas assez de fermes autour. En plus, les pieds dans une herbe qui ne soit pas une pelouse de stade, ça pourrait risquer de ramener des esprits primitifs à la conscience d’un réel en deçà du social. Manifester sur une île, pour prendre un autre exemple, ça comporte trop de connotation post soixante-huitarde, entre autres inconvénients. La rue, par contre, est un lieu idéal. C’est le lieu social par excellence, où faire des choses vraiment personnelles paraît toujours un peu décalé : y manger son steak, y résoudre une intégrale multiple, y faire l’amour, y méditer transcendantalement, sont des activités possibles, mais pas très idoines. C’est pour tout dire un lieu quelque peu d’irréalité, où l’on ne peut guère accomplir que ces sortes d’activités qui passent pour les plus essentielles aujourd’hui, mais qui sont en fait très abstraites et secondaires, au sens où ce ne sont que des moyens pour autre chose, du genre se transporter ou communiquer. Donc c’est un bon lieu pour sociorevendiquer. Cependant, comme tout espace, il comporte ses contraintes structurelles, qui ne sont en soi ni positives ni négatives, mais qu’il faut savoir utiliser.
La contrainte la plus évidente est que c’est un lieu étroit et non extensible, dans le sens de la largeur, alors qu’il offre une dimension indéfinie dans le sens de la longueur. Cette dernière qualité est à double tranchant : elle assure qu’il n’y aura pas de limitation quantitative de contenu, mais elle implique de ce fait que la validité de la revendication sera jugée sur la longueur du cortège. Il ne faut pas trop s’étonner du caractère apparemment gratuit de cette mesure. L’homme est habitué depuis longtemps par la science, de la clepsydre au thermomètre, à cette transposition d’une valeur intensive en une quantité extensive. On jugera donc de la validité d’une protestation, au nombre tenu de jours de grève de la faim, ou à la longueur d’occupation des rues, selon le cérémonial adopté. Deux considérations viennent alors imposer l’idée de la marche comme action techniquement idoine. La première est que, puisqu’il s’agit d’occuper la longueur, c’est effectivement une action que l’on ne peut guère faire en groupe qu’en long, c’est même l’action qui par excellence occupe la longueur. Il est certes possible, à titre individuel, de marcher de long en large, mais collectivement, ça ne peut se faire qu’en long, exemple supplémentaire, s’il en était besoin, que le collectif mutile l’individuel. Dans les cortèges bien ordonnés, on ne laisse d’ailleurs généralement pas trop les manifestants commettre des fantaisies dans le sens de la largeur, car celui qui se met vraiment à se mouvoir dans le sens de la largeur, n’est plus un manifestant, mais un individu qui vaque à ses occupations ou a ses fantaisies. La deuxième est que la marche occupe la longueur plus loin que sa propre occupation au sol instantanée, et en ce sens, c’est plus subtil qu’un thermomètre, qui se contente de montrer ce qu’il y a. Il est donc dans l’essence de la procession de s’étirer.
Maintenant, sans même nous occuper du lieu, réfléchissons à ce qu’il serait possible d’œuvrer en commun dans le cadre d’une foule. Si la foule est là en référence à un homme providentiel dont il s’agit de faire valoir la transcendance historique, il est évidemment préférable de la maintenir immobile, vis-à-vis profane destiné par son grand nombre à faire saisir par une analogie implicite la grandeur identique de l’homme seul, perché pour plus de sécurité symbolique, derrière sa tribune. On n’attend alors de cette multitude que son nombre, et comme elle ne s’étend physiquement qu’au sol, qu’elle crie par moments quelques ovations, pour occuper l’espace en volume. Mais si la foule est là de manière démocratique, c’est-à-dire sans chef qui fasse trop chef, il va bien falloir trouver un principe d’unification, pour que cet agglomérat toujours plus ou moins hétéroclite, fasse manifestation, unitaire, comme on précise parfois. Cette affaire d’unification est une condition indispensable pour que la chose soit reconnue comme telle, sinon on n’y verrait qu’une dispersion aléatoire d’individus, ce qui serait, à plus d’un titre, totalement opposé au but recherché. Et là, sauf dans le cas paradoxal et subtil de l’enterrement, ou de la manifestation en faveur d’un homme emprisonné ou condamné, plus question de se servir d’un nom comme principe unitaire. Il faut donc trouver quelque chose de commun. Ce quelque chose n’est pas facile à trouver, même s’il s’agît d’une manifestation assez catégorielle. Même parmi les motards, les chômeurs, les paysans, ou ce que l’on voudra, il y a nette diversité dans les individus, tant physiquement que mentalement. Ne pouvant donc que difficilement trouver quelque chose de significatif existant réellement en commun, il faut alors faire quelque chose en commun, concevoir une action en commun. Mais, vu la diversité mentionnée, plus grande est la foule, plus difficile il sera de trouver quelque chose que tous soient effectivement capables de faire, sans de plus que n’apparaissent de trop grandes diversités, notamment qualitatives, dans l’accomplissement de la dite chose. Se gratter le nez tous ensemble, par exemple, serait possible, mais ne conviendrait pas bien, à cause entre autres de connotations symboliques relatives à l’utilisation sociale du corps. Marcher est vraiment l’action idéale, car quelques soient les divergences culturelles, les différents degrés d’intelligence, les compétences sportives des individus en jeu, presque tout le monde qui ne soit pas handicapé, parvient à le faire, et même souvent, arthrose mise à part, avec une certaine aisance, un certain savoir-faire, qui peut ainsi symboliser le sérieux, voire la compétence de l’acte protestataire. Que maintenant cet acte n’ait, la plupart du temps, aucune espèce de rapport avec le problème auquel il est censé s’affronter, n’est que querelle de mauvaise école.
Un psychanalyste cruel, mais heureusement contesté, notait que l’on fait toujours l’amour tout seul. S’il est bien par contre quelque chose que l’on puisse faire ensemble, c’est marcher. La remarque ne vaudrait évidemment pas pour ces marches plus substantielles que sont la marche en montagne, la marche sportive, ou même la marche sur un terrain boueux ou caillouteux, cas d’espèces où réapparaîtraient ces si fameuses et vilaines inégalités . Mais la bonne vielle marche revendicative standard sur bon bitume social, ça vous conforte l’égalitarisme à merveille. Côte à côte, ne faisant plus qu’un dans ce rythme élémentaire si sophistiqué qui consiste à mettre un pied devant l’autre, puis à recommencer. Quelque soient les inavouables fantaisies individuelles qui parviennent malgré tout à se frayer une petite voie dans les têtes individuelles, il reste la tranquille solidité de ce geste commun et serein, attestant que l’esprit universel, ou l’esprit saint, ou le progrès social – peu importe le nom d’école qu’on lui donne - , existe bel et bien. La simplicité du geste, sa quasi vacuité mentale, donnent ce sentiment fort de vivre ensemble, de lutter ensemble, d’être dans le vrai mouvement, échappant à la désespérance existentielle causée par l’allure brownienne des vacations individuelles. Quoi de mieux, pour se sentir solidaire, que de marcher ensemble ? Déjà, pour mieux communiquer, on fait volontiers, à titre privé, quelques pas ensemble. Alors, tous, d’un pas uni, vers l’horizon meilleur…
Car la procession a toujours ce sens métaphorique d’une progression vers un avenir radieux. C’est le progrès, progressus, action d’avancer. Une manifestation qui marcherait à reculons ne ferait pas sérieux. Imaginez, rien que sur le mode privé, que le poor lonesome cowboy ne s’éloigne pas vers l’horizon de sa piste, mais traverse latéralement l’image, ou pire, revienne du lointain. Et si l’on fait des mises en scène genre manifestation contre les armes atomiques, ou autres calamités d’origine humaine, dans lesquelles tout le monde doit solidairement se coucher au sol, pour simuler la perspective de mortalité de masse incluse dans la chose contestée, c’est pour mieux a contrario montrer que la posture normale symbolisant la vie est celle du marcheur. Ainsi marche-t-on vers l’avenir, dans le bon sens, qui est d’ailleurs souvent le fameux sens de l’histoire, que certains prétendent avoir l’incroyable chance d’avoir sur leur boussole personnelle. Des naïfs prétendront qu’on marche dans le bon sens, parce que le bon sens est celui dans lequel on marche. D’autres, plus incurables encore, que la véritable fin de l’histoire, c’est toujours la mort du héros, même si c’est de vieillesse, que la vieillesse est toujours un naufrage, que la beauté de l’horizon est donc toujours affaire de myopie. Mais l’humanité en marche, ou l’échantillon qui s’en croit sur l’heure représentatif, ne s’en laissera pas compter de la sorte, et ne renoncera pas si simplement à ses projections téléologiques. Marcher, c’est aller quelque part, et, sauf cas d’errance, on fait généralement semblant de savoir où l’on va. Le fait de ne pas savoir où l’on va est réservé aux marginaux, aux mendiants, ou à la rigueur à l’homme normal en cas de détresse morale. Le manifestant sait où il va, vers la justice. La justice étant le nom précisément de ce que pourquoi on lutte, ce vers quoi on se dirige, par exemple la défense du droit de propriété, ou encore le droit d’occuper les logements vacants, ou quoique ce soit d’autre qui est certainement défendable d’un certain point de vue, même si tout cela diverge manifestement dans toutes les directions. Marchons, mes frères, mes camarades, et la pluie finira bien par tomber.
Bien sûr, pour en découdre, il faut toujours des témoins. D’abord, parce qu’il est dans la nature même de la dispute d’en appeler à témoin. Il n’est rien de plus sinistre et de plus frustrant que de rester vainqueur sans témoin. Et si l’on ne peut pas trouver d’hagiographe, il vaut encore mieux un témoin de mauvaise foi, genre rescapé du camp adverse, pour témoigner du combat. Pourquoi croyez-vous qu’on ait inventé le diable ? C’est qu’une fois créé dieu, il fallait bien quelque chose d’autre que lui-même et ses propres œuvres, pour en attester. Le criminel parfait éprouve certainement une grande jouissance à avoir trompé tout le monde, mais une déception aussi grande à être seul à le savoir. La marche a donc bien comme fonction essentielle d’attirer l’attention sur. Sans doute, de nos jours, le meilleur moyen à la fois d’attirer l’attention sur, tout en réussissant le paradoxe que ce ne soit sur rien de bien déterminé, voire sur rien du tout, c’est de chanter derrière une caméra de télévision, enfin ce cérémonial curieux de couleurs bigarrées, de rythmes élémentaires, de gesticulations simplettes vaguement accompagné d’une sonorité d’ameublement, qu’on appelle souvent chanter. Mais il y a la prégnance encore importante de l’héritage historique. Avant les petites lucarnes électroniques dites de télévision, et bien avant les petites fenêtres internautiques du web, le symbole de la vision sur le monde extérieur était la grande lucarne, la fenêtre usuelle. La distribution se faisait alors selon une logique inverse. Au lieu de diffuser la même image multipliée en grand nombre à l’intérieur de chaque foyer par l’intermédiaire du duplicateur télévisuel, il fallait trimballer l’image de fenêtre en fenêtre. C’est pourquoi le lieu idéal de la manifestation était une grande ville, munie de grands immeubles latéraux le long des rues, offrant ainsi une grande densité de fenêtres d’où voir l’affaire. Sans compter qu’une composante fréquente de la chose est précisément d’inquiéter le présumé bourgeois calfeutré derrière sa fenêtre, qui est justement, semble-t-il, le lieu naturel du bourgeois. On voit bien d’ailleurs de nos jours, qu’il existe une école plus moderne, utilisant les techniques du jour, en pratiquant des exhibitions plus limitées dans l’espace et dans le temps, ce qui est plus commode pour les professionnels de la retransmission. L’intérieur d’une église peu avant vingt heures est, par exemple, un choix judicieux d’espace-temps. Les tenants de l’ancienne école s’en tiennent, quant à eux, aux traditions, et préfèrent encore la marche. C’est pourquoi cette manière de faire reste privilégiée pour les groupements manifestant des manières plus archaïques, comme les syndicats ou les églises. Les bonnes vieilles façades de fenêtres restent donc consubstantielles à la vraie marche de tradition.
S’il faut les témoins, il faut bien sûr ne pas oublier l’ennemi. Car une marche sans ennemi à abattre serait simple stupidité. Toute marche vers l’avenir, donc toute marche, est une contredanse, et possède nécessairement sa figure symétrique, fut-elle fantasmatique. Tout avenir radieux doit se payer, et parfois même dans le sang, ça ennoblit la cause. De grands philosophes l’ont d’ailleurs largement justifié, pour des causes diverses. Dans le sang des autres, de préférence, évidemment. Mais là où nous marchons vers notre justice du moment, le sang impur n’est jamais bien loin d’abreuver nos sillons. On marche fondamentalement contre, même si l’on préfère n’insister que sur le côté le plus présentable, le côté pour et pur, juste et tout ça. Dans toutes ces marches, il y a la volonté virile d’en découdre. Et la volonté virile d’en découdre n’est souvent que l’appellation édulcorée de la bêtise et de la haine, ces deux fameuses jumelles, qu’on ne voit bien que de loin. Mais attention, la bonne haine chaleureuse que nous confortons avec amour en notre sein, se doit de rester toujours plus ou moins implicite. Sauf cas de crise extrême, ou encore de troupes un peu trop primitives non contrôlées, on préférera de nos jours éviter de brandir la tête du ministre, du patron, ou du violeur d’enfants, même factice, au bout d’un pique. Car il est évident qu’entre gens avides de justice, on n’en veut a priori à personne en lui-même, que l’attaque n’est pas, par principe, ad hominem, mais contre l’acte ou l’idée en cause. Cependant, derrière le prétendu principe, en guise d’injustice à combattre, il nous faut bien un vrai méchant en chair et en os, et qui si possible ait la tête de l’emploi, ce qu’on trouve généralement assez facilement. Le vrai méchant étant plutôt celui, comme nous-mêmes présentement, qui a besoin de poser quelqu’un en face de lui comme méchant, nous dirons donc que ceux qui songent à résoudre un problème en termes de processions ne sont pas simplement simplets, mais méchants.
Une figure intéressante de l’ennemi, spécialement adaptée, est le contre-manifestant. C’est une espèce rassurante, elle nous conforte dans notre certitude de ne pas nous être trompés de monde. Le contre-manifestant est un salaud, et en plus un idiot, puisqu’il marche à contresens. Mais sa démarche diabolique nous montre bien qu’on ne s’est pas trompé sur la logique des choses. La procession est bien l’expression ultime du bien et du mal, et même les forces maléfiques se trouvent contraintes d’en accepter le principe. C’est un dispositif intelligent, parce que réversible, à l’insu des protagonistes. Car le processionnaire ignore, non par accident, mais par nécessité intrinsèque, qu’il n’est qu’un contre-manifestant pour le déambulateur inverse. Ainsi, chaque cortège, ignorant que le nord de l’endroit qui est au sud est au sud de l’endroit qui est au nord, trouve sa contre-justification dans la marche inverse. Ca pourrait donner des situations amusantes, si elles n’étaient chargées de leur haine et de leur contre-haine réciproque et justificatrice. Quand les forces du parti de gauche-sud-est procèdent en sens inverse de celles de celui de droite-nord-ouest, elles sont solidaires sur l’arrière-fonds essentiel, c’est qu’il faut marcher. Les vrais ennemis de la justice sont alors les immobiles, qu’on taxera d’immobilistes, pour la raison qu’ils ne déambulent que de manière pragmatique. Les justiciers marcheurs se verront bien contraints de marcher un jour contre ceux qui osent narguer leur donquichottisme pédestre. Abreuvons donc nos sillons, tout en marchant, tout en marchant, du sang impur de ceux qui ne mettent un pied devant l’autre que pour aller quelque part, ou, encore pire, pour simplement se promener.
Pour changer de registre
 | Par l'auteur de cette page, quelques textes pouvant valoir le détour : les recueils de nouvelles. |
màj 220610 |