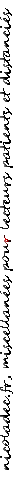|
prononciation |  |
Petite biographieFils d'un professeur de mathématiques et d'astronomie de l'Université de Harvard, Charles Sanders Peirce s'intéressa très jeune à la logique. Il obtint un diplôme de chimiste. Il souffrit toute sa vie de névralgie faciale, expliquant un caractère difficile, instable et dépressif, et sa tendance à l'isolement social. Travaillant de manière intermittente dans des travaux de géodésie et de gravimétrie pour le "United States Coast Survey" de 1859 à 1891, il fit à ce titre plusieurs séjours en Europe. Il mena une carrière de scientifique, notamment comme assistant de l'observatoire astronomique de Harvard, et fut élu membre de l'Académie nationale des sciences en 1876. Il fut apparemment le premier à définir le mètre à partir de la longueur d'onde d'une certaine fréquence de lumière. Il fut conférencier en Logique en 1879 à l'Université John Hopkins. A partir des années 1880, son activité professionnelle eût à souffrir de son activité de recherche dans les domaines de la logique, de la philosophie et de la science, sujets sur lesquels il écrivit de nombreux articles pour le "Century Dictionary". Il perdit tout emploi régulier à partir de 1891. Sa carrière fut handicapée par sa personnalité assez asociale, mais aussi par l'hostilité personnelle d'un autre scientifique de renom, Simon Newcomb. Sa première femme le quitta en 1875, et divorça en 1883. Entre-temps, il vécut avec celle qui devait devenir ultérieurement sa seconde femme, Juliette Froissy. Cette situation lui fit perdre son emploi à l'Université, et l'empêcha d'en retrouver un ailleurs, grâce aux bons soins de Newcomb. A l'aide de l'héritage de ses parents, il s'achète en 1887 un domaine rural sans rapport économique près de Milford, en Pennsylvanie. Il y construisit une grande maison dans laquelle il passa le reste de sa vie dans une certaine pauvreté, à poursuivre une oeuvre aussi prolifique que morcelée, et bien sûr non publiée. Il parvint à survivre grâce à l'aide d'amis, et aussi d'admirateurs, principalement le philosophe William James, qui lui dédicaça sa "Volonté de croire", et intervint de manières diverses en sa faveur. Celui qui fut, selon Bertrand Russell, le plus grand penseur américain, et qui est reconnu de nos jours comme tel, mourut à Milford en 1914, dans l'oubli et la pauvreté, laissant derrière lui une oeuvre immense et dense, avec des centaines de milliers de pages manuscrites. |
Une pensée sans commencement ni fin
Le sens philosophique le plus courant du terme "intuition", avec des variantes éventuellement importantes selon le contexte philosophique, par exemple chez Descartes ou chez Kant, est l'existence d'une connaissance immédiate, qui n'est pas la résultat d'une connaissance intérieure. Or, en cela fidèle à la formule hégélienne selon laquelle l'immédiat est toujours déjà médiatisé, Peirce nie la possibilité même d'un donné quelconque qui ne soit pas résultat du passé de la connaissance. C'est qu'il y a une illusion de l'intuition. : " il est clair que c'est une chose d'avoir une intuition, et que c'en est une autre de savoir intuitivement que c'est une intuition. " Le prétendu pouvoir intuitif de reconnaître qu'une connaissance n'est pas le produit d'une connaissance antérieure est tout à fait illusoire. Il n'y a au fond guère de différence entre considérer comme absolue la crédibilité d'une autorité et considérer une intuition comme un donné irréfutable. " Tout avocat sait combien il est difficile pour les témoins
de distinguer entre ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont inféré. " Berkeley a ainsi montré comment la perception de la troisième dimension de l'espace est une inférence, et non une donnée des sens. Vouloir absolument remonter à un premier terme est peut-être un besoin psychologique, notamment par
peur de la "régression à l'infini", mais relève néanmoins d'une illusion rétroactive.
Ainsi la pensée n'a ni commencement ni fin assignables : en
deçà, même s'il en va du devenir que cela finisse par nous échapper, il y a toujours déjà eu nécessairement quelque chose ; au delà l'essence du sens est
d'être appel vers son sens futur, par la poursuite inéluctable des interprétations.
Contre DescartesPeirce étudia la philosophie à Harvard. Grand lecteur de Kant, il estimait retrouver dans la rigueur de la méthode kantienne l’esprit du laboratoire scientifique. Une autre grande découverte fut pour lui la lecture de « De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle » de Darwin. Il commence ses recherches en logique mathématique en 1866, et rejoint le camp des anticartésiens en 1868. |
La vérité, convergence à terme.Contrairement à Descartes, qui en bon mathématicien, pense que l'on peut établir définitivement une vérité, comme on le fait d'un théorème, et que c'est affaire de raison menée par un sujet, Peirce, plus "physicien", conçoit la vérité comme affaire de convergence à long terme des recherches scientifiques. Peut être considérée comme vraie l'opinion qui survit aux tests et sur laquelle, après ample critique et discussion, s'accorde la communauté des chercheurs. Une philosophie de la significationQue sont donc les idées et où sont-elles ? Mauvaise question, mal posée, qui nous lance sur la fausse piste de la recherche d'une sorte d'objet non physique à trouver quelque part, au fond du cerveau, dans un ciel transcendant, ou dans les abimes d'un quelconque arrière-monde. Les idées sont des conceptions, mais attention au piège de la substantivation : une conception n'est qu'en oeuvre, elle est ce qu'on conçoit, qu'on a conçu, qu'on concevra, pas "quelque chose", mais un processus sans commencement ni fin assignables. Alors, qu'en est-il de ce processus, qu'est-ce que concevoir quoi que ce soit ? |
L'éventail des croyancesDire qu'une chose est dure, c'est croire que dans certaines circonstances, elle se comportera d'une certaine manière (par exemple, elle résistera si je tente d'y enfoncer quelque chose). Toute conception est de ce type : c'est croire qu'il y aura
tel comportement dans telle circonstance. Toute conception relève donc d'une croyance, c'est à dire d'une habitude mentale qui guide l'action. Evidemment, les habitudes n'ont pas toutes même valeur. Il faut donc s'interroger sur "Comment se fixe la croyance". |
Une signification interminable
Il n'existe de pensée qu'à travers des signes. Mais, à la différence du dualisme usuel en la
matière (par exemple opposant signifiant et signifié), Peirce analyse le fonctionnement du signe de manière tripolaire. Pour qu'il y ait signification,
il faut bien qu'il y ait un signe matériel dénotant un objet de pensée, mais cela ne fonctionne que parce qu'il y a un troisième terme, qu'on a tendance à occulter : l'interprétant, qui est celui qui établit une représentation mentale de la relation entre le signe et l'objet. Le signe, possibilité même de signifier, est premier, l'objet, c'est à dire ce dont on parle, est second, mais il ne faut pas oublier le troisième terme, qui effectue la relation de signification, l'interprétant.
Une grande originalité de Peirce est de considérer que l'interprétant peut, à son tour, être considéré comme un signe susceptible d'être à nouveau interprété, et ainsi indéfiniment. Le mot "chien" est un signe, l'objet est ce qui est désigné par ce mot, et le
premier "interprétant" est la définition que nous partageons de ce mot. Ce premier degré est ce que Peirce nomme le fondement du signe. A partir de là, je peux me représenter un chien particulier, vous en parler, devenant alors pour vous à mon tour un signe, amorçant en votre esprit d'autres interprétations, qui à leur tour en amorceront d'autres : le processus de signification est sans fin.
La logique : revalorisation de l'abductionL'opposition entre rationalisme et empirisme est souvent rabattue sur l'opposition entre deux types d'inférences : la déduction et l'induction. La déduction est le raisonnement logique et, sauf erreur, indiscutable, par lequel on déduit une conclusion certaine de prémisses supposées vraies. C'est la méthode "officielle" du mathématicien. L'induction, sorte d'inférence statistique, déduit que, puisqu'on a jusqu'ici toujours obtenu tel résultat, on peut considérer que c'est une loi, ce qui repose sur une sorte de passage à la limite qui en soi ne prouve rien, et qui suscitera notamment, après Hume, la réflexion de Kant et l'amènera à poser la notion de transcendantal. |
Toute image est construiteOn sait depuis Berkeley ("Sur la vision") que la perception d'une troisième dimension de l'espace, disons la profondeur, n'est pas du tout une intuition immédiate, mais une déduction de l'esprit. |
Empirisme et métaphysique
Tenir pour vérité ce qui plaît à l'esprit : telle est la genèse traditionnelle des conceptions métaphysiques. Peirce n'accorde évidemment aucune valeur de vérité à ces inventions agréables (ou non), qui prétendent décrire le monde indépendamment de toute expérience. Mais cela n'exclut aucunement la préoccupation métaphysique. On peut légitimement enquêter sur la possibilité même de toute réalité. Trois niveaux d'interrogation se dégagent alors : la question de la possibilité même de toute réalité (priméité), celle de son existence effective (sécondéité), celle de la règle qui la gouverne (tiercéité). Toute existence peut être décrite à la fois comme action et comme réaction. Mais cette description reste insuffisante si elle ne s'interroge pas en deçà sur sa possibilité formelle et au delà sur son insertion dans une série à laquelle il appartient. Ainsi cette montre-ci n'existe d'une part qu'à partir du principe de la mesure de la durée, d'autre part comme exemplaire particulier des montres en général.
Peirce reste par ailleurs sous l'influence de Darwin, avec une conception évolutionniste du monde. L'expérience mène à considérer l'univers comme un vaste continuum, où les séparations ne sont que des abstractions temporaires. Il y a une réalité du hasard, qui se reflète dans l'utilisation des probabilités en science. Il nomme tychisme cette conception de l'univers comme processus indéterminé, bien que régi par des lois.
Pour en savoir plus :
T.P.I. sur voir sans avoir vu (la tache aveugle).
Le site de l'édition des œuvres de Peirce (en anglais).
Un extrait sur l'espace et la durée
L'édition des œuvres de Peirce en français aux éditions du Cerf (Claudine Tiercelin et Pierre Thibaud).
Claudine Tiercelin, C.S. Peirce et le pragmatisme, PUF
Charles Sanders Peirce, Le raisonnement et la logique des choses, PUF (un peu difficile, mais accompagné d'une longue introduction
biographique et philosophique).
Pour changer de registre
 | Par l'auteur de cette page, quelques textes un peu moins éducatifs, et qui néanmoins valent le détour : les recueils de nouvelles. |
màj 220704 |